Le penseur spinoziste est intervenu récemment dans un événement militant pour y défendre la rédaction de ses articles, donnant ainsi lieu à une conférence, censée poser le débat entre ceux qui se présentent actuellement comme les deux pôles du summum de la radicalité « révolutionnaire » française. Intervenant à un moment précis de l’histoire collective, qui vit enfin une repolitisation, la conférence avait pour objet de mettre en scène un débat contradictoire qui finalement n’a pas lieu.
Alors que le public et les organisateurs s’attendaient à une réelle discussion, il semble que des scrupules amicaux et une absence de participation de la salle ait rendu l’émergence d’une contradiction impossible.
L’intéressé a donc eu tout le loisir – sans être repris par quiconque – de dérouler ses arguments avec l’habileté rhétorique qu’on lui connaît. Voilà ce que nous avions néanmoins à lui opposer.
A la lecture de ces lignes, d’aucuns pourraient croire que nous n’aimons pas cet auteur. Nous n’avons pourtant cherché qu’à dire ce qui nous semble vrai, et ceci, en des temps meilleurs, pourrait-être pris comme le signe de la plus indéfectible amitié.
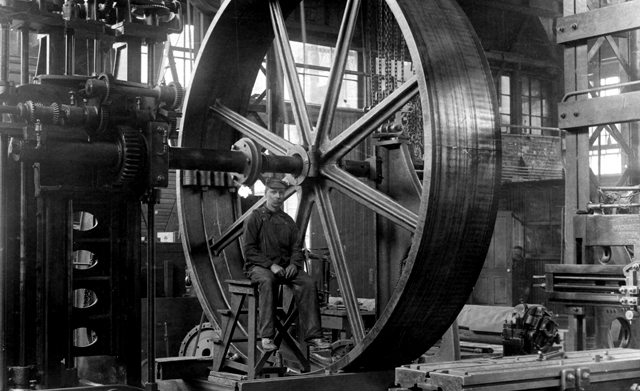
I
Le premier point de friction fut celui de la position des « intellectuels » avec notamment, une référence bien sentie à leur inaptitude à vivre. La question a un peu embêté l’intéressé, qui, après avoir fait mine d’en faire un grief personnel, a finalement défendu en général la position des « intellectuels » comme « producteurs d’effets » par le biais de leur « pensée ». Tout était à reprendre.
Il est piquant de constater – pour quelqu’un qui prétend avoir lu Marx, et dont le compte en banque est régulièrement fourni en argent « public » – que jamais M.Lordon n’a envisagé de répondre à la question de la séparation du point de vue social. Lui qui pourtant fait grand cas de la division du travail, semble avoir oublié que la situation dans laquelle il se trouve est celle de quelqu’un qui vit de l’argent prélevé sur l’exploitation des autres, contre lequel on lui donne le droit de la commenter. Sa défense rétrograde des « intellectuels » a pourtant pour fondement réel ceci : sa place dans la division du travail, due à la bénévolence d’un État, et à sa propre conformité (il est vrai, partiellement révolue) aux exigences d’une pensée compatible avec lui.
Ainsi, le voir se réfugier derrière l’oxymore « intellectuel critique », qu’il qualifie pourtant de pléonasme, prête fort à rire : des intellectuels critiques, il n’y en a jamais eu, sans doute y-a-t-il eu des penseurs de cet ordre, mais ceux-ci avaient également d’autres habiletés, et en outre, n’étaient pas payés par l’État.
Croire au rôle d’« intellectuel », c’est accorder du crédit à « la machine lourde et pesante » qu’est la réflexion des spécialistes, comme dirait Nietzsche, mais c’est encore se tromper lourdement sur ce qu’est la pensée. La pensée n’est que l’expression verbale, la recherche d’une articulation de la sensibilité, lui donnant par là d’immenses moyens critiques et prospectifs.
Il était donc touchant d’entendre un intellectuel critique avouer devant une salle comble qu’il « ne savait pas faire grand chose d’autre » – misère de la spécialisation.
Néanmoins, même Nuit Debout – dont il fut un instigateur principal – a eu des effets de politisation dont l’époque frémit encore, bienheureusement dépassés par l’apparition des Gilets Jaunes. Le problème d’endosser le rôle de « machine à concepts » deleuzienne, et son destin d’innocuité et de péremption, M. Lordon doit bien le sentir : il lui reste encore à l’admettre.

II
Si pour beaucoup M. Lordon brille par ce qu’il pense, il brille surtout pour nous par ce qu’il ne pense pas. Ainsi, interrogé par un de nos camarades sur les médias et son néologisme de « gorafisation » du monde, il botte en touche façon Bourdieu. D’abord disant que sa position est médiane entre « ne pas aller » et « aller » dans les médias, pour ensuite expliquer qu’il faut avoir la certitude de « pouvoir y dire quelque chose » sans pour autant que « cela marche à chaque fois. » Et une fois avoir – de façon canoniquement petite bourgeoise – décrit un côté, puis l’autre du problème, il s’arrête satisfait pour passer au second thème.
Nous aimerions d’abord rappeler que cette « critique » bourdieusienne des médias – qui suppose un État néo-mitterandien pour enfin produire un « contenu médiatique de qualité », – façon Hors-Si-j’y-suis ou Là-bas-série – n’a rien compris au problème.
Aujourd’hui plus qu’à aucune époque, la question médiatique n’est pas un champ séparé – au sein duquel on pourrait bourgeoisement trier le bon grain de l’ivraie. On ne peut se donner bonne conscience parce que l’on produit du « contenu critique » qui serait magiquement exempt de déformation par sa médiation, proprement idéologique. La question est toujours, dans un temps comme le nôtre, de faire émerger une rupture dans ce qui a dénaturé le rapport au réel dans son fondement, de briser ce qui est devenu à terme, le seul réel connu. Chacun d’entre nous a une responsabilité personnelle dans le refus ou la complaisance vis-à-vis de conduites spectaculaires, qui prolongent ou interrompent la fausseté de la vie même. Mais l’aveu que nous fait M.Lordon est en fait ceci : il ne veut pas renoncer à sa notoriété médiatique.
Nous sommes ainsi régulièrement touchés de voir les têtes du milieu gauchiste ou autonome se plaindre à foison, en privé, de l’admiration sans recul dont elles font l’objet. Et, dans le même temps, nous voyons ces gens ne supporter aucune critique, ne jamais questionner l’origine des comportements spectaculaires auxquels ils cèdent et qu’ils font émerger chez les autres, pour finalement ne rien changer à leur attitude. Le monde actuel est tellement intoxiqué d’idéologie que ce qui n’est pas critiqué est immédiatement reconduit. Mais ceux-là le savent, ou feignent de l’ignorer et y dérogent par calcul. Échappe au terrorisme médiatique qui veut bien.
Concernant la « gorafisation » du monde, l’intellectuel critique remet le couvert : le néolibéralisme (sic), son caractère horriblement obscène mais néanmoins réel, tend à rattraper sa parodie, et autres arguments émoussés au point de la rupture. Là encore tout est à renverser : nous vivons bien plus un temps où les images prescrivent un usage délirant du monde, qu’un temps où le réel serait en phase de les rattraper. Que reste-t-il à falsifier quand le faux s’est déjà réalisé ?
Pour comprendre la « gorafisation » du monde, il fallait déjà commencer par comprendre « Le Gorafi ». Et pour ce faire, il suffisait, en bon sociologue, d’ouvrir Adorno : « L’ironie mensongère qui s’est installée dans le rapport des intellectuels béni-oui-oui et de l’industrie culturelle n’est nullement limitée à ce groupe. On peut supposer que la conscience des consommateurs est elle-même scindée, placée qu’elle est entre la plaisanterie réglementaire que leur prescrit l’industrie culturelle, et la mise en doute à peine déguisée de ses bienfaits. » (nous soulignons). C’est précisément cette scission – depuis largement augmentée et développée – sur laquelle agit le site d’information parodique : elle convient parfaitement à l’époque et à ses citoyens-prototypes. Ils sont évidemment abusés partout, mais cet abus est éminemment supportable parce qu’ils le savent, et devient par là finalement dérisoire. Ils peuvent en sortir grandis, fiers d’être des experts-spectateurs.
S’il en avait poursuivi la lecture, M. Lordon aurait pu également trouver : « L’idée que le monde veut être trompé, est devenue plus vraie qu’elle n’a jamais sans doute prétendue l’être. » « Non seulement les hommes […]tombent dans le panneau […] mais ils souhaitent même cette imposture, tout conscients qu’ils en sont. » Et cet « humour » a encore une fonction sociale, qui n’est pas celle de l’expérience de la rupture du langage, mais bien de ridiculiser toute tentative de prendre au sérieux un monde si ouvertement parodique. On sait comment sont traités, dans la vie courante, ceux qui commettent le crime de prendre certaines choses avec gravité.
« S’amuser » (que nous prenons ici au sens médiatique, tout à l’opposé d’un jeu réel) « signifie toujours : ne penser à rien, oublier la souffrance même là où elle est montrée. Il s’agit, au fond, d’une forme d’impuissance. C’est effectivement une fuite, mais pas comme on le prétend, une fuite devant une triste réalité ; c’est au contraire une fuite devant la dernière volonté de résistance que cette réalité peut encore avoir laissé subsister en chacun. »
L’originalité du « Gorafi » est le caractère plus actuel de sa parodie, qui se sait parodique et se présente au second degré, comme une parodie du simulacre qui n’est plus qu’une simulation de parodie. L’ancienne satire provoquait une réaction, celle-ci produit l’anesthésie. L’ironie contemporaine dont le Gorafi fait preuve passe évidemment par son aspect prospectif, anticipateur à court-terme, qui était à la base le trait de dystopies authentiquement critiques. Ce qu’il faut mettre en miroir de cette distance affectée, c’est l’ampleur réelle des désastres qui jalonnent la marche de la société marchande.
C’est pour mieux correspondre au totalitarisme du spectaculaire concentré, c’est-à-dire à la phase de transition entre le capitalisme tardif et le régime cybernétique naissant – que cette « ironie » a été intégrée à la critique spectaculaire du spectacle, qui, lorsque la conscience historique était moins gangrenée, était contrainte en permanence de simuler l’indignation. Mais ce n’est pas parce que la vie des sociétés modernes devient effectivement désastreuse et absolument bureaucratique que M. Lordon peut prendre le reflet de la vie sociale pour son modèle.
C’est au contraire l’absurdité réelle des sociétés actuelles, mélange de Kafka, d’Orwell et d’Ubu Roi, qui est à l’origine de cette parodie, puisant dans le degré maintenant atteint – et surtout divulgué en public – du délire autoritaire et idéologique des classes dominantes. Classes dominantes chez qui effectivement la négation pathologique de la vérité atteint des sommets, mais Machiavel nous avait prévenu : « le poisson pourrit par la tête ».

III
Une fois interrogé par nos camarades sur l’éventualité révolutionnaire, M.Lordon s’est mis en tête de rabattre le gros des arguments que nous avions battu en brèche il y a cinq ans (Voir Des rives et du torrent) et quelques autres, qu’il avait forgé pour l’occasion. Nous saluons au passage la disparition des catégories mélioratives de « police » et d’« armée » de son champ lexical.
Poussé néanmoins dans ses retranchements par nos amis, il put révéler ainsi le fond de sa pensée « onto-anthropologique »(sic), citant Spinoza comme le font les curés – en latin – en disant que « l’homme est un dieu et un loup pour l’homme ». Insistant de tout son poids sur le « et ».
Nous ne résistons pas à la tentation de rappeler l’intellectuel critique à ses lectures. Marx écrit par exemple : « la critique de la religion est la condition première de toute critique ». Il est assez affligeant qu’après des siècles de critique sociale, la figure funeste d’un barbu dans l’espace refasse apparition – même métaphoriquement – dans une discussion sérieuse.
Situer l’homme entre le loup et dieu est un cliché aussi éculé que de le situer entre l’ange et le cafard, ce qui a surtout pour fonction, comme il y a quelques années, de ne rien dire sur le devenir historique de la question. Cette manœuvre est là pour légitimer une stase – position offensive prisée par les intellectuels critiques. Mais l’histoire s’étant remise en mouvement, voilà l’intellectuel critique contraint à une stase mobile, celle de l’équation équilibrée, sans troisième terme.
Et puisque c’est à ce moment que M. Lordon a émis des doutes sur « ce qu’il était », qu’on nous permette de le rassurer, il est encore économiste, du moins au sens d’Engels, quand il écrit que « les économistes ne tranchent jamais rien. »
La controverse révolutionnaire, que M. Lordon veut situer entre Hobbes et Kropotkine, a aussi peu d’intérêt que les débats stériles sur la violence ou la non-violence qui agitent les milieux militants. Il s’agit en fait, sous deux vieux vêtements, d’un débat plus vieux encore entre moralité et amoralité.
À ce moment, hélas, la métaphysique du Comité Invisible fut convoquée pour faire réponse. Avec pour seul résultat ce que produisent immanquablement deux métaphysiques qui se rencontrent : un nuage d’abstraction.
Qu’on nous permette de ramener tout cela sur terre : si M. Lordon cherchait une définition de l’homme, il aurait pu en trouver de plus décisives, comme, celle, très actuelle, d’Élisée Reclus : « Ne peut-on pas dire que l’homme est la nature qui prend conscience d’elle-même ? » et celle de Marx : « L’homme, c’est le monde de l’homme. ». On ne définit jamais rien par hasard, tout l’enjeu d’une définition est de savoir comment l’on va s’en servir.
Ces deux définitions ne se réduisent pas à une tension entre deux pôles mais donnent à voir un processus. L’homme, s’il a une substance, est celle d’être agent d’une transformation de la nature, dont il est pourtant issu. Il y a seulement à comprendre, et pas seulement à déplorer abstraitement, que celui-ci s’est développé – à quelques exceptions historiques près – par la culture contre la nature et dans la culture contre lui-même, par la captation tyrannique des pouvoirs. Tout l’enjeu du siècle, qui intervient après deux cents ans de critique sociale, réside dans la prise de conscience de la nécessité d’une transformation qui ferait finalement jouer ensemble, de façon mutuellement réciproque, la nature organique et culturelle de l’humanité. Par là, la spécificité de l’homme, comme agent conscient d’une contradiction à la nature serait finalement retrouvée, en même temps qu’une réconciliation avec le vivant deviendrait possible.
Mais un tel diagnostic est impossible à poser, comme ce programme inenvisageable pour les adeptes religieux – qu’ils soient déistes, spinozistes ou métaphysiciens, critiques ou non.
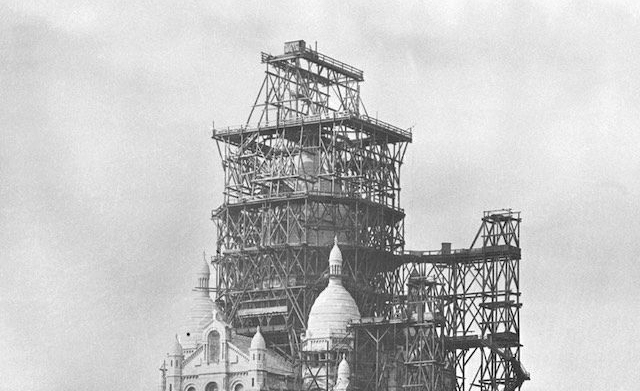
IV
Le point le plus intéressant de la soirée fût sans doute atteint au moment de l’opposition entre constitution et destitution. Poussé dans ses retranchements, Frédéric Lordon a dû, cette fois encore, non seulement faire état d’un dissensus, mais aller au bout de ce qu’il pense. L’ébauche d’une vraie discussion a pu alors avoir lieu.
Quand notre ami évoque les réunions pré-communardes, et le fait qu’elles formaient activement le tissu de la Commune de Paris, M. Lordon est obligé d’acquiescer. Seulement, lire cette période de maturation, ou même la Commune de Paris, comme une « destitution » et y plaquer les catégories de l’affabulation agambennienne est plus que problématique : il est clair, documenté, établi que la Commune ne faisait pas une « politique » métaphysique sans médiation, de « négativité pure ». Il est beaucoup plus exact, comme l’a rappelé notre camarade, de dire que ces prémices, comme les Gilets Jaunes, contenaient en eux-mêmes des formes politiques affirmatives, dont aucune institution n’avait à prendre le relais. Il y avait non seulement le tissu social des banquets, mais de multiples conseils et assemblées, finalement, la Commune venue, une forme politique et même un président.
L’écueil inverse, en revanche, qui consiste à plaquer sur la Commune le fétiche « d’institutions », de spéculer, comme le fait M. Lordon dans Impérium, sur une capture inéluctable par une minorité « si la Commune avait dû se maintenir », tient de la pure projection. Nous notons cependant un déplacement sémantique louable dans la rhétorique de M. Lordon : lui qui, il y a cinq ans, disait très fort que « l’État c’est nous » et décrétait que tout groupement humain « secrétait » physiquement de l’État, ne parle à présent plus d’État, mais « d’institution » qui transpirerait de nos pores. Là encore, il faut tout reprendre.
D’abord, poser quoi que ce soit à ce degré d’abstraction brouille toute lecture possible des événements. Il n’y a ni « destitution » ni « constitution » abstraite. Ce qu’il y a bien plutôt, et c’est ainsi que notre camarade aurait pu conclure son propos sur les banquets précédant la Commune – c’est de la destitution constitutive et de la constitution destituante.
Dans les affaires humaines, c’est-à-dire, historiques et limitées dans leurs possibles, une forme politique en chasse une autre, pour en produire une nouvelle : même la plus informelle des ententes est un nouvel ensemble dont la négativité n’est qu’un moment.
Par contre, tout l’enjeu est de connaître la qualité de cette nouvelle forme politique, et précisément de savoir si elle est institutionnelle ou non. L’exemple le plus récent, le mouvement des Gilets Jaunes, que tout le monde écrase de ses catégories au lieu de chercher à le comprendre, montre bien l’unité globale de ces deux moments et même le changement qualitatif que suppose une forme politique contre-institutionnelle. Doit-on le préciser : aucun groupement humain ne sécrète spontanément une « institution » qui suppose une séparation de la vie quotidienne, une médiation extérieure au collectif, fondamentalement verticale. Il y a par contre un jeu politique permanent, que l’institution vient justement interrompre.
Tout le problème de la notion de destitution, c’est le refuge qu’elle représente pour s’éviter la formulation positive d’un destin commun. Cette formalisation par la négative a le même caractère fourre-tout que la notion d’insurrection, issue de la même littérature. Il s’agit en fait, non seulement de s’éviter un problème, mais surtout d’en contourner un autre, si la destitution permet de ne jamais se poser la question de l’après – « continuons le début » pouvait-on lire en 2016 – l’insurrection permet d’occulter la différence, pourtant fondamentale, entre révolution politique et révolution sociale. Le printemps arabe et l’hiver ukrainien du début des années 2010, maintes fois cités, ont bien failli sur ce plan : le pouvoir est démis certes, mais sans articulation de ce fait politique avec une appropriation collective des moyens de la survie collective, eh bien le pouvoir se remet très vite en place, aidé en plus de l’armée. Ce vocable qui a pour effet de tout déplacer vers la sphère politique, fait comme si la décision et la formation d’affects communs résolvait spontanément le problème de la production du monde. Ce qu’il y a, c’est qu’une simple révolution politique est aujourd’hui impossible. On peut parfaitement imaginer un énième coup de force de type néo-gaulliste une fois Macron démis par la masse fluorescente.
Cependant, les Gilets Jaunes résistent et à la déprimante passion lordonienne de l’institution et aux catégories insurrectionnalistes, précisément par l’articulation, dans les meilleurs moment du mouvement, des assemblées et des blocages, voire des émeutes et des destructions de péages. Et le caractère motivant à l’excès de ces dernières semaines tient à ce que la propriété semble justement avoir perdu une partie de son aura, dans l’habitude d’un usage collectif retrouvé. Il y a bien, formalisation par les assemblées, sabotage, approvisionnement, et fêtes, potlatchs, le retour même de l’amour dans un siècle où l’on pouvait le croire définitivement perdu.
Même du point de vue de son rapport à la représentation, à la capture ou à la récupération, le mouvement des Gilets Jaunes reste exemplaire. Il est la démonstration vivante que le développement des forces productives, notamment des moyens de « communication » même cybernétiques, peuvent être utilisés pour permettre une horizontalité vécue, sous une forme efficace. En ce sens, les Gilets Jaunes sont à Nuit Debout ce que 1793 était à 1789 : l’un se perdant dans un jeu de rôle finalement incantatoire, un formalisme politique pré-mâché pour la récupération, mais dont le désir vague se trouve finalement réalisé : les ronds-points valent mieux que les centre-villes, et les prolétaires mieux que les gauchistes.
Il n’y a donc ni malédiction métaphysique à la formalisation positive, ni de prévention naturellement humaine au développement d’une société formalisée organiquement. Ni de pureté de la destitution, ni nécessité de l’institution, et cela, les Gilets Jaunes en sont la preuve. Leurs « leaders » ont même parfois le bon goût de se retirer, des médias compris, une fois leur tâche estimée accomplie, ce qui, on l’espère, pourra inspirer les intellectuels critiques et autres stratèges de Kabbale.
Tout l’enjeu futur, pour les Gilets Jaunes, réside dans le maintien de cet état de fait malgré la confusion interne, notamment vis-à-vis d’une récupération d’extrême droite lors des prochaines élections présidentielles. D’autres, comme Juan Branco, espèrent une récupération à gauche, et y vont de toutes leurs malsaines manoeuvres pour ressusciter la sociale-démocratie au profit de leurs ridicules ambitions personnelles. Récupérateurs au rang desquels le clown-triste Ruffin fait la paire avec Branco, l’un comme Monsieur Loyal de la France Insoumise, l’autre en Che Guevara de l’école Alsacienne.
Le plus lucide de nos camarades disait d’ailleurs ce soir-là qu’il fallait que « l’autonomie » questionne son rapport à ces figures troubles, qui finiront bien par abattre leurs cartes au moment de la distribution des ministères. Le jeu de « qui perd gagne la radicalisation » pourrait être onéreux à l’avenir.

V
Le dernier point d’intérêt a porté sur la controverse à propos de l’économie. Là encore, les termes du débats sont problématiques : nous avons d’une part « sortir de l’économie » pour le Comité Invisible, auquel M. Lordon oppose l’impossibilité d’une sortie de l’économie, toute survie collective étant, par définition, « économique ».
Le mouvement historique serait donc réduit à cette double impasse : ou bien une échappée métaphysique du régime capitaliste, par la fragmentation du monde, l’alignement des planètes et des plans de consistance, ou bien l’économie perpétuelle dans le monde de la prédestination spinoziste. L’une et l’autre option ne sont pas seulement démoralisantes, elles sont impossibles.
Du point de vue plus politique, ce n’est pas tant parce que, pour paraphraser un auguste critique de la valeur, une fragmentation de la société serait nécessairement barbare que nous n’y croyons pas. C’est plutôt que, cette fragmentation de territoires qui regagneraient en autonomie par la floraison des communes ne peut être qu’une étape dans un monde où un État ou plusieurs leur feront la guerre, qu’il s’agisse d’un État autochtone ou de puissances extérieures. La question de l’articulation des territoires se posera nécessairement face aux tentatives certaines de reconquête.
Du point de vue de l’économie cette fois, la « France léopard » pleine de tâches sombres d’autonomie, sera nécessairement adossée à une production capitaliste persistante, à ce qui peut en être détourné, pillé. Encore une fois, un tel maillage territorial sera ultimement transitoire, et à terme insuffisant. Même du point de vue des « formes-de-vies » pour user du terme wittgensteinien consacré, plaquer l’horizon révolutionnaire sur une telle hypothèse est d’un ennui profond. Tout cela risque de dégénérer en survivalo-réformisme, qui suppose le maintien de toute une structure de production : le traitement de l’activité comme travail, sa distribution, peut-être même les échanges. L’entraide clandestine est un moyen efficace de résistance, pas un quelconque horizon révolutionnaire.
Il est clair que l’hypothèse de M. Lordon est pire encore. Il est aussi clair que sous couvert de qualifier d’économies les sociétés anthropologiques ou tout groupement humain négociant sa survie avec la nature, M. Lordon cherche bien à conserver le gros de la société actuelle, dépouillé de sa « gangrène néolibérale » pour retrouver la santé interventionniste. Il n’y a qu’à lire les multiples textes de prescription que celui-ci produit encore (surtout ceux sur la question dite « européenne ») qui nous rappellent bien à quoi servent les formations d’économistes ou de sociologues, et autres brevets dans l’assistance technique de mécanismes de dominations, sujets eux aussi à l’obsolescence programmée.
C’est là sa dissonance fondamentale : M. Lordon prend philosophiquement des teintes révolutionnaires – et encore, des teintes pastels – mais ne range jamais ses propositions politiques ou même économiques sur ce terrain. Bien qu’il ne l’ait jamais dit clairement, il apparaît évident que cette conviction de la prédestination anthropologique à l’économie est précisément le point qui articule sa philosophie et ses thèses politiques, bien que lui-même, peut-être parce qu’il cherche encore ses convictions (ce qui est louable) ne l’ait jamais explicité.
De deux choses l’une, si toute production de vie collective se résout « onto-anthropologiquement »(sic) en économie, alors on ne peut pas en sortir. Mais si en sortir signifie organiser la survie dans les ruines, alors, on n’en sort pas non plus. M. Lordon pérennise l’économie in abstracto et ad vitam, ce qui est, comme le marque le latin, un travers de philosophe. Le Comité Invisible et ses semblables pérennisent eux le communisme comme fin de l’économie, mais à partir d’une projection infinie de la condition présente, et non comme dépassement ; ce qui est un travers de militant.
L’économie n’est jamais que la dernière forme historique de production et de conception du rapport humain au milieu vivant. Rapport, cela a été suffisamment dit, essentiellement mortifère, comme le montre la définition de l’argent selon Hegel : « Le mouvement de ce qui est mort se mouvant en soit-même ». L’aura mortifère de ce mouvement est aujourd’hui passée du temporel au biologique. Cependant, comme toutes les choses humaines, l’économie n’est pas éternelle.
C’est précisément à notre époque que l’ordre du jour cybernétique entend réaliser l’économie, et donc acter cela. L’artificialisation du milieu vivant que supposerait l’avènement cybernétique – insoutenable organiquement par la planète, mais c’est là précisément un de ses leviers d’accélération – transformerait assurément tout. Ses tenants ne s’en cachent pas. Les rapports humains intégralement transactionnels et bureaucratiques seraient intégrés à l’économie, mais par une médiation qui déléguerait la transformation du milieu aux machines, en conditionnant la survie réelle de chacun aux chaînes d’un incessant traitement d’information symbolique. Ce projet, qui est en marche, est d’une telle barbarie rationaliste qu’il induit un changement de qualité vis-à-vis de l’ancienne économie, qui suppose encore une contradiction avec le milieu, que la cybernétique cherche à convertir en pure tautologie d’accroissement.
Ceci prouve, même au plus forcené des philosophes, que l’économie n’est pas la vocation nécessaire de l’homme, mais seulement le fait d’habiter et donc d’entretenir une certaine relation au monde qui le traverse et qui l’entoure. Ce qu’il faut donc, c’est, par le communisme, produire un nouveau rapport, que nous proposons comme d’autres avant nous de centrer autour du jeu ; qu’il soit entendu au sens physique de relation dynamique, de libre construction culturelle, de relation individuelle et sociale, ou au sens fondamental du mouvement de la vie.
Ce nouveau rapport, s’il venait à voir le jour, ne s’émancipera pas des contraintes de l’entretien et de l’approvisionnement, autant d’aspects traités par l’ancienne économie. Mais il aura à les enrichir d’une dimension esthétique et existentielle, par le biais de cultures dont le sens nouveau pourrait affranchir ces tâches de leur dimension économique et démoralisante. Chacun voit bien que le fait de devoir se nourrir peut-être vécu, dépendamment du degré de liberté dans la société, comme un plaisir ou un chantage. On voit bien que la cybernétique, qui n’est rien d’autre que la rationalisation du point de vue des machines sur le monde humain, se propose déjà de faire tout cela à l’envers, en conditionnant la survie réelle à un enchevêtrement bureaucratique et esthétisé du traitement d’information. Certains de ses citoyens-prototypes mangent même de simples substituts nutritifs déshydratés, en attendant de pouvoir charger leurs batteries sur des bornes électriques.
Là encore les Gilets Jaunes, avec les potlatchs de ronds-points, le retour au don et au partage, montrent la voie hésitante d’un communisme actuel, faisant renaître, dans un lieu unitaire, le carnaval et l’espace public, mais aussi l’abondance réelle, perdue dans la consommation capitaliste. Encore faudrait-il, pour le comprendre, regarder la vie réelle comme porteuse concrète d’aventures. Mais ce qui manque à ces messieurs-dames, c’est autant la dialectique que l’imagination.
— 25.05.2019
