Cédez-leur et aussitôt vous rencontrerez une nouvelle exigence plus considérable, car on pensera que la peur a, cette fois déjà, entraîné votre soumission.
— Périclès

Avant-propos
Contrairement à ce que beaucoup veulent croire, la crise grecque n’est pas grecque. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une crise en Grèce, qu’elle est dans l’œil du cyclone. On a voulu faire du pays un exemple à plusieurs niveaux : d’abord pour son mépris traditionnel des lois, des institutions, du fonctionnement « normal » de l’économie, ensuite pour avoir résisté aux décisions des représentants bureaucratiques de la propriété internationale. Mais surtout, on a pu le faire parce que la nouvelle configuration politique de la domination rend une telle prise de pouvoir possible, et même facile. Le capital qui dictait sa loi nationalement peut à présent le faire à une tout autre échelle.
La fusion du cours mondial de l’histoire avec un tel mode économique n’a pas fini de se payer de conséquences. Contrairement à ce que voudraient faire croire tant d’idéologues, ce n’est pas le développement naturel, nécessaire et irréductible de la vie des hommes. C’est bien plutôt une production historique qui poursuit son chemin, la domination délibérée de ceux qui en sont les garants, domination insuffisamment comprise et critiquée par ceux qui la subissent et y adhèrent encore.
Qui regarde bien observe partout les mêmes régressions, qui sont autant d’ajustement à une conception du monde qui se croit auto-suffisante. Le durcissement général des conditions d’existence est parallèle à l’approfondissement de cette logique marchande, dont le désolant monopole est insuffisamment contredit. Les bureaucrates et propriétaires internationaux jouent sur le désemparement et la stupeur que leurs manœuvres, devenues subitement plus brutales, induisent chez les populations. Ils comptent plus que jamais sur la démission sociale.
Il reste que ceux qui subissent de plein fouet leur démesure sont aussi les plus à même de l’éteindre, et « plus encore qu’un incendie », conformément au souhait d’Héraclite. C’est pour eux que sont écrites les pages qui suivent.

La crise
Le discours médiatique fait apparaître les crises financières, la fraude fiscale et la dette publique comme des phénomènes étanches, distincts les uns des autres, alors qu’elles ne sont que les étapes d’un seul et même mouvement. Ce sont les effets de la forme actuelle de la domination économique, ses conséquences logiques.
Le fait de toujours les présenter comme des désagréments extérieurs au fonctionnement supposé pur et parfait de « l’économie de marché » est le meilleur masque pour faire oublier ce que les « crises » sont vraiment : les résultats, pour partie voulus, parfois orchestrés mais toujours entretenus d’un choix dans la construction historique de la société des hommes. Choix qui a échappé au grand nombre et qui est encore maintenu contre lui.
Un économiste reconnu, ingénieur du sauvetage du capitalisme après la crise de 1929, a dit un jour que « l’économie est un pari sur l’avenir ». C’est là une façon polie d’admettre qu’elle est un mensonge sur le présent. Mais il a reconnu un de ses traits essentiels, celui d’être un mensonge nécessairement dynamique, ne se prolongeant que par anticipation.
Sous ce régime, l’activité des hommes est intégralement soumise à un but prospectif, à l’entretien d’un cycle dont on a décrété l’éternité, celui de la valorisation marchande. La transformation d’argent en plus d’argent est aussi bien la condition de son fonctionnement que le moyen de sa perpétuation, celui de son actualisation permanente. Le capitalisme s’est transformé profondément il y a quarante ans, pour maintenir ce cycle, lors d’une crise sans précédent. Les décisions prises alors sont les destructions que nous vivons aujourd’hui.
Après la seconde guerre mondiale, on avait vu l’ouverture de marchés plus larges, plus vastes, plus étendus, qui incluaient finalement dans le cycle de consommation ceux-là même qui produisaient les marchandises, et qui en étaient auparavant privés. Mais cette manne de profits qui avait étendu et développé le capitalisme connaissait à présent une limite. Même en produisant plus, plus vite, moins cher, en dégradant toujours plus la nature des produits pour élargir les marges, en généralisant la perte de qualité et le remplacement par le synthétique pour renouveler les stocks, les profits ne reviendraient pas. Le progrès technique développé durant les « trentes glorieuses » devait bien un jour se retourner contre ceux qui en avaient si largement profité : les technologies qui avaient permis des profits se sont généralisées à tel point qu’elles n’en dégageaient plus, et les bénéfices escomptés sur la production et la vente ne suffiraient jamais à entretenir la dynamique aveugle de l’économie – argent, marchandise, argent – au niveau mondial.
Ce que l’on a fait passer pour une autre crise boursière, plus tard pour les « chocs pétroliers » était en fait une crise du principe de l’économie, en tant que production de choses vouées à être rentables, perpétuellement rentables. Avec les derniers progrès de l’automation, notamment informatiques, une économie dont la source de rentabilité première était la production des choses menaçait de s’effondrer.
Au moment même où il trébuchait sur ses propres limites, le capitalisme était critiqué dans ses fondements, son fonctionnement était troublé par des révoltes internationales profondes – notamment celles de l’année 1968, et des gouvernements avaient dû délaisser des pays entiers, des semaines durant. Des travailleurs en étaient même venus à réclamer la pleine possession de leur travail, voire de leurs vies.
Pour le pouvoir du capital et de l’État, il fallait répondre au plus vite à cette double crise, économique et historique, en satisfaisant simultanément deux nécessités vitales. D’abord protéger les moyens de produire, usines et autres, que les vieilles structures n’avaient pas empêché les mouvements populaires de saisir et d’occuper, ensuite dépasser la baisse, les limites de profits qu’une économie de la production matérielle imposait structurellement aux capitalistes.
La nouvelle vague de financiarisation fut la réponse idéale à cette double crise. Après 1929, la spéculation financière avait été mise au rebut contre une économie productive plus policée, qui assurerait un meilleur contrôle social. Les mouvements de capitaux avaient été limités, les révoltes durement matées et l’instabilité spéculative mise entre parenthèses.
En 1971, avec la fin de la conversion de la richesse mondiale en or, la spéculation a retrouvé sa place centrale au sein du système marchand. La technologie informatique – dont la généralisation des gains de productivité outranciers minaient l’économie productive – devint le support d’une richesse virtuelle illimitée, et garantirait les marchés contre les fluctuations trop périlleuses. Ce qui était un frein devint un levier, et on put, grâce aux ordinateurs, passer d’une société de la valeur abstraite productive à la valeur abstraite simulée, abattre ainsi toutes les frontières pour l’argent et débrider tous les appétits.
La décennie qui suivit fut celle de la jubilation capitaliste d’avoir surmonté les contradictions et la contestation d’alors, et le départ du mouvement historique dans lequel nous nous trouvons. Crise historique et économique étaient à présent oubliées. Non contente d’avoir ouvert à l’infini les possibilités de profits, la financiarisation nouvelle eut pour conséquence de créer un échelon international de mobilité et d’anonymat pour les propriétaires. Le développement de la finance actionnariale devait supplanter tous les patrons, ou les absorber, créant des trusts internationaux libres de tous les mouvements. Les gouvernements n’étaient pas en reste, et orchestraient la légalité de tout ceci, quand ils n’y prenaient pas ouvertement part commercialement, comme en Italie. Les « paradis fiscaux » furent multipliés pour préserver les profits simulés et le marché mondial put faire de la terre son royaume de Dieu.
Ce même échelon international, associé à la virtualisation de la richesse mondiale mit également à l’abri de toute atteinte populaire le capital ainsi formé, ainsi que la détention des moyens de produire. Si les ouvriers venaient à s’emparer de l’usine, voulaient une meilleure paye, ou simplement contestaient les conditions qui leur étaient faites, la richesse des actionnaires demeurait sauve, libre de circuler mondialement, bientôt en quelques secondes.
La logique marchande, combattue précédemment, avait désormais en main les moyens de son approfondissement sans retour. Toute la production devint dès cet instant le moment accessoire d’une transaction financière internationale. On vit alors des institutions monétaires dont le rôle n’était qu’administratif, se muer en arbitres de la rentabilité internationale. L’extension mondiale de ce chantage eut pour conséquence directe le déclenchement d’une nouvelle « accumulation primitive ». Le déploiement potentiellement illimité de la valeur, ainsi que sa dématérialisation relative, devait rejouer sur un terrain beaucoup plus grand encore l’accaparement initial de l’instauration de « l’économie de marché. »
Le capital avait dû, historiquement, exproprier les paysans de la terre, les artisans et les citadins de leurs moyens de subsistance pour qu’ils soient contraints, s’ils voulaient survivre, de travailler pour lui aux conditions qu’il fixait. Mais ce qui se limitait encore au travail, à la production, devait à présent s’étendre à tous les domaines de l’existence. La production devenant une source de profits secondaires, au moment où le travail était, grâce au progrès technique, presque économiquement superflu, la spéculation, de plus en plus volatile, avait désormais les moyens de s’immiscer partout.

L’impasse
Une telle prédominance du capital fictif met « l’économie de marché » dans un état de totalitarisme paradoxal. Le capitalisme est devenu, grâce au retournement de la situation en sa faveur, subjectivement inébranlable – puisqu’il est partout dans l’esprit de ceux qui le vivent, au moment où il est objectivement, dans le mécanisme de création de valeur qui l’a porté historiquement, extrêmement fragile. Ceci explique pourquoi il n’y a désormais plus de « choix » politique possible. Céder sur une partie pourrait mettre en péril l’ensemble du système, les gouvernants le savent et agissent tous en conséquence.
Le passage d’un capital de production à un capital fictif virtuel s’accompagne de deux conséquences historiques : d’une part pour les populations, c’est un durcissement généralisé du contrat passé sur leur vie.
Les possibilités de spéculation transforment ce qu’il reste d’économie productive en prétexte à plus-value virtuelle, approfondissant partout le diktat de la propriété, étendu bientôt à toute la vie sociale. Dans les pays les plus avancés, c’est la disparition du salariat qui est compensée par la dispersion totale de la valorisation sur l’intégralité de l’existence, chez les autres, c’est la matrice concentrationnaire du siècle dernier qui joue désormais à plein. La spéculation sur smartphone et les villes-usines chinoises sont des formes différentes de la même exploitation, la soumission totale des individus à l’impératif de création de valeur. L’une est une forme pseudo-ludique, l’autre purement policière, du salariat permanent.
D’autre part, le capital fictif renouvelé représente pour la classe dominante une marge de manœuvre sans précédents depuis deux siècles au moins. La fluidité du capital virtuel généralise l’accaparement originel, la prédation violente et toutes ses conséquences, que les juristes appellent timidement « corruption ».Les intérêts de la classe dominante mondialisée ne s’en trouvent que renforcés. Au niveau national ou plus élevé, on peut être ministre des finances et associé d’une des plus grandes banques d’affaires, marchand d’armes et député, Président de la République et conférencier aux honoraires dorés. Aussi le monde politique n’est pas peuplé de conflits d’intérêts mais d’une perpétuelle concordance de ceux-ci.
Du point de vue plus directement mercantile, la soumission de tout le mode de production au capital fictif voit l’émergence d’un capitalisme de convention, au sein duquel l’évaluation de la valeur abstraite – pourtant dès le départ un simulacre arbitraire et depuis lors une opération infaisable – devient centrale. Les échanges commerciaux deviennent une guerre du mensonge qui trouve sa plus belle expression dans l’avant-garde de la spéculation : le secteur bancaire. Difficile en effet de distinguer, quand elle est si volatile, la valeur simulée d’une spéculation rentable, et la valeur simulacre, qui n’est qu’un prétexte à transaction, un arrangement périmé et insolvable.
La crise de 2008 fut une crise de la solvabilité privée : les banques comprirent trop tard que les profits escomptés ne viendraient pas, l’immobilier américain, mais également bien d’autres « titres » se révélèrent trompeurs. Les pauvres, que l’on avait déguisés par divers emprunts, étaient en fait demeurés pauvres. Le crédit, ce moyen par lequel la société se prend comme objet de spéculation en pariant toujours sur son essor, s’effondra. L’illusion de prospérité dissipée, on retrouva toutes les caractéristiques de l’époque : la fragilité des mécanismes de valorisation spéculatifs du capitalisme, et leur caractère politique, tours de passe-passe d’une classe propriétaire internationale censée ne pas exister.
Le but et l’objet de l’organisation sociale étaient nus ou presque, et le labeur de tous, ainsi que les « sacrifices » demandés depuis trente ans à toutes les populations parlaient maintenant par leur résultat, historiquement redondant : la domination de classe.
Les États sont donc intervenus, en rendant solvables ceux qui ne l’étaient plus, tout en faisant quelques exemples, en laissant certaines banques aller à la faillite, mais en sauvant le reste. Sitôt les banques renflouées, le spectre des dettes publiques a été brandi partout, comme un mal qui venait de se déclarer. Les gouvernements n’ont eu de cesse de préparer la venue de ces chevaux de Troie : en établissant les cadres légaux sur la spéculation de leurs propres titres de dette, en réduisant volontairement les impôts des riches pour les faire peser sur les autres, en organisant la fraude fiscale, en vendant au secteur privé les parts rentables de leurs entreprises pour ne conserver que les plus déficitaires.
La soudaine « crise des dettes publiques » a permis, simultanément, une diversion quant à l’insolvabilité de la finance mondiale minée par la valeur simulacre des « actifs toxiques », une augmentation générale du champ spéculatif en compensation des pertes subies par les capitalistes en 2008, une prise de pouvoir politique permettant le durcissement de tous les rapports sociaux à l’échelle de pays entiers, et enfin la soumission des populations contestataires par le chantage à la survie.
En Grèce, les manœuvres furent grossières et voyantes : les comptes publics furent aggravés par l’institut national de statistiques avec l’aide de consultants de Goldman Sachs, et avec la bénédiction du gouvernement Papandréou, pour faire venir la « Troïka » plus tôt. La dette n’explosa qu’après l’application du premier mémorandum et une campagne de dévaluation des agences de notations et des obligations grecques par les fonds d’investissements. Par ailleurs, le recouvrement de la fraude fiscale à l’échelle européenne – dont une large partie a été orchestrée par l’actuel président de la Comission lorsqu’il était premier ministre au Luxembourg – serait à même de solder toutes les dettes publiques. Les politiques « d’austérité », aux dires de tous, ne peuvent qu’aggraver la situation économique présente.
Contre ceci, rien n’est fait, parce que ce qui se déroule est voulu, et l’État, maintenu artificiellement au bord de la faillite, ne peut qu’acquiescer aux demandes mercantiles. Ainsi, au contraire du renversement médiatique qui voudrait que la dette ait été une cause, que l’austérité soit la conséquence nécessaire et la fraude fiscale une donnée négligeable, nous disons plutôt : l’austérité est la cause, l’endettement public est la conséquence et l’organisation de la fraude fiscale le moyen d’obtenir cette dette.
« L’austérité » est un mot traître. L’histoire retiendra que les possédants ont ajouté l’injure à l’infâme en appelant ceux que leur richesse étouffe à plus de frugalité. « L’austérité » est le nom donné à l’intensification de la valorisation mondialisée, une mesure extrême correspondant aux besoins extrêmes de « nouveaux marchés » de la mécanique économique sous perfusion. Elle est l’affront général d’une classe qui, non contente de faire sombrer les hommes, peut et veut faire sombrer la planète pour son seul avantage, et a tout le loisir de le faire en drapant ses manœuvres obscènes derrière une apparence morale. « L’austérité » se fait par et pour la propriété internationale, au seul profit de la néo-aristocratie financière des fonds d’investissement et des banques d’affaires, des entrepreneurs cybernétiques et des magnats du pétrole, des mafias privées comme des services secrets.
D’ailleurs les « zones de libre échange » qui fleurissent sur la surface du globe ne témoignent pas d’autre chose : elle sont l’organisation, la coordination et la coopération des classes dirigeantes à une échelle qui satisfait les besoins actuels du capital. En Europe, nous avons un parlement du capital mondial - dont les amendements sont parfois les copies exactes de ceux des lobbys qui les subventionnent, une Commission du capital mondial, présidée par le chef de la fraude fiscale du continent Jean-Claude Juncker, une banque centrale du capital mondial, présidée par un ancien salarié et actuel actionnaire de la plus forte banque d’affaires du monde, et nous aurons bientôt des tribunaux internationaux qui seront du même acabit. Toutes les « formes démocratiques » sont prêtes à être bafouées et le seront autant que nécessaire . « L’Eurogroupe » n’a naturellement pas d’existence légale, mais peut ruiner un pays entier. Nous retrouvons tardivement la sagesse des Athéniens, qui disaient déjà : « Vous savez aussi bien que nous que, dans le monde des hommes, les arguments de droit n’ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens de contrainte équivalents et que, si tel n’est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus faibles n’ont qu’à s’incliner. »
On a vu en Grèce les termes du chantage qu’une telle position de pouvoir rend possible. « L’austérité », comme dictature bureaucratique de l’économie politique fonctionne comme un piège à double niveau. Non seulement la solvabilité des comptes publics est exigée par ceux qui organisent l’insolvabilité de ces comptes, mais les mêmes ont en main la politique monétaire.
Ce qui s’est joué lors du référendum, finalement trahi, est en somme ceci : si un pays croit pouvoir s’opposer à la marche forcée des émissaires du capital, ce pays se voit coupé l’accès à la monnaie, c’est-à-dire privé d’accès à la valeur abstraite, dans un monde où toute la survie y est pourtant assujettie. Par cette manœuvre, la propriété privée est maintenue politiquement par ceux qui se réservent le droit, quand ils le désirent, de la priver de son support économique qu’est l’argent. Elle se retourne alors en dévastation sans égal.
Les peuples sont donc confrontés aux deux options suivantes : ou bien la situation économique et sociale se dégrade, mémorandum après mémorandum, et fait plus lentement mais aussi sûrement du pays un pur terrain de jeu spéculatif duquel ils sont naturellement exclus, ou l’économie est sapée d’un coup d’un seul, la rendant immédiatement à la merci d’un marché mondial omniprésent. La Grèce peut être en ruines, la fortune des riches est ailleurs, et le pays n’en sera que plus facile à racheter.
En conséquence, la « Troïka » et les États mettent tout à vendre, musées, ports, les îles mêmes peuvent être bradées, les contours nationaux altérés par ce mouvement qui marque la carte aussi sûrement que la guerre. Il y a là beaucoup de profits à faire pour ceux qui sont du bon côté de la barricade – pour l’instant financière. Pour la large masse des populations, par contre, c’est le retour aux conditions de vie du xixe siècle, qui fait retrouver les taux de suicide, les maladies comme la tuberculose et la syphilis, bientôt la mortalité infantile d’alors.
Ce qui est source de profits pour les uns est une cause directe de mort pour les autres. L’opposition d’intérêts entre dominés et dominants est telle qu’elle retrouve le terrain de la vie biologique. Il est seulement à déplorer que la guerre économique faite aux populations, faute de conscience historique, ne trouve chez elles que des exutoires stériles.

L’erreur
Le parti Syriza est arrivé au pouvoir en promettant l’effacement de la dette « publique ». Ses représentants prétendaient atteindre ce but par une bonne gestion politique de l’économie, sans la moindre remise en cause des structures capitalistes de la société. C’était, au dire de tous les médiatiques, l’option la plus radicale que le peuple grec avait à sa disposition ; son seul espoir d’en finir avec la dictature économique. Ils oubliaient seulement de préciser que c’était l’option électorale la plus radicale, ce qui est une contradiction dans les termes.
L’élection permet de changer les têtes d’une structure politique inchangée, bâtie pour défendre et justifier les bases économiques de la société qui sont la source de tous les désastres que nous avons sous les yeux. Le vote condamne d’avance toute transformation de l’existence qui nous est faite. Ce qui convient à ces messieurs de Syriza, qui n’avaient pas d’autre ambition que de s’attaquer à la dernière humiliation en date, la dette, et garder précieusement intactes toutes les précédentes qui, comme dans les bonnes tragédies, conduisaient fatalement jusque là. C’était impossible et cela n’a pas eu lieu.
Les partis politiques reproduisent à moindre échelle l’organisation de l’Etat, et surestiment un pouvoir institutionnel qui est à la fois leur but à atteindre et leur fonctionnement pratique. Ils sous-estiment ainsi la profondeur du problème économique, parce qu’il est soumis dans leur esprit au seul objectif de la conquête du pouvoir. Ce que nous voyons pourtant, c’est que la dette soumet l’appareil d’État grec autant que la population. Cette même logique marchande qui a donné naissance à l’État national lui retire à présent tout pouvoir. à cette échelle, il ne lui sert que de relais et de police : il n’a même plus l’initiative des lois ou le contrôle de sa monnaie. L’État-nation est devenu la caricature de ce qu’il a toujours été, c’est-à-dire une entreprise comme une autre, dont le monopole s’effondre. Syriza s’est hissé à la tête d’une force périmée.
Pendant un petit tiers du XXe siècle, la machine étatique n’a freiné les appétits des marchands et organisé une infime redistribution des richesses que pour trouver une issue satisfaisante à des conflits sociaux, pour éviter le pire. L’État a pu paraître providentiel parce qu’il fallait que la manière douce succède à la manière forte, compte tenu de l’agitation sociale que laissait présager une Europe ruinée par la guerre. On a ainsi pu répondre à la brutalité née des rapports de production capitalistes et à la défense barbare de la propriété privée par le maintien du capitalisme. L’ensemble des consciences de gauche croit donc que l’État s’est opposé au mode de production quand il n’a fait que le servir.
Or, la domination d’aujourd’hui n’accepte pas même d’être adoucie. L’épisode du référendum le montre bien. Le rapport de force est tellement favorable aux capitalistes qu’on ne se soucie guère de montrer au peuple toute l’étendue de son impuissance, qui est maintenant aussi celle de ses représentants officiels. Les dernières apparences démocratiques volent en éclat, et les électeurs grecs n’ont même plus à être trompés par les gens qu’ils élisent. Ils sont humiliés par d’autres qu’ils n’ont pas élus. Les réformes en faveur des travailleurs, autrement dit les négociations portant sur les conditions de l’exploitation (et jamais sur son principe) ne sont plus possibles. Il n’en est plus question, avec la nouvelle extension de la domination économique et le nouvel échelon politique dont elle se dote.
Le réformisme et l’illusion démocratique se tenaient l’un l’autre. C’est parce que le capitalisme maintenait la possibilité d’aménager politiquement l’exploitation que l’impuissance du plus grand nombre semblait compensée, que la vaste majorité pensait avoir une marge de manœuvre sur ses conditions de vie, même si cette influence était infime et s’exercait par représentants interposés. Ces miettes de changement étaient la base matérielle du mythe républicain, sa réalité concrète. Une fois ôtée, le mythe s’effondre. Le réformisme sombre et entraîne les apparences démocratiques avec lui.
Du même coup, Syriza ne peut plus gouverner. Qu’est-ce qu’un parti de gauche qui ne peut rien réformer ? Le voilà dans l’impasse ; il est privé des moyens de sa politique. La plupart de ses dirigeants, préférant exercer le pouvoir plutôt que tenir leurs engagements, se résignent et servent les intérêts qu’ils prétendaient combattre. D’autres, relativement plus intègres, refusent. Le parti se scinde en deux, et l’aile gauche de Syriza espère renouer avec le réformisme, en soustrayant la Grèce à la domination de la bureaucratie européenne par un retour à l’État-nation. Ces grands hommes ont l’espoir vain de revenir par un chemin politique à un état antérieur du mode de production, alors même que c’est le nouvel état du mode de production qui provoque le bouleversement actuel.
Même en admettant que ces véritables sociaux-démocrates parviennent à leurs fins, la démocratie dont ils rêvent, comme le réformisme qui lui sert de support et d’horizon, n’existent que par la dictature économique. Les extrêmistes du parti ne veulent pas d’une démocratie réelle, mais espèrent retrouver son apparence politique sur laquelle ils pourraient enfin régner. Ces nostalgiques défendent l’ancienne forme de l’État contre la nouvelle, comme si l’une valait mieux que l’autre, alors que la même scène se rejoue, seule la grandeur du théâtre a changé.
Le principe étatique reste la domination d’une partie de la population sur l’ensemble de la société, partie qui prétend incarner les intérêts du tout, en décidant pour lui. Mais nos sociaux-démocrates ne contestent pas le principe de l’État, seulement sa taille, maintenant qu’il leur échappe. Ils souhaitent revenir à une forme antérieure de la même exploitation pourvu qu’ils y retrouvent leur poste, et la part de pouvoir qui leur est due.
Ce sont des petits-bourgeois de la politique. Ils vivent dans la hantise du déclassement, et ont finalement été déclassés. D’un côté, nos boutiquiers voient les dégâts que causent le capital à leur profession, en ayant trouvé des serviteurs plus haut placés ; de l’autre, ils savent bien qu’ils y perdraient autant si le capitalisme tombait :il s’agit avant tout de garder leur place. Nos sociaux-démocrates sont écartelés entre la nécessité de garder intacte une société qui leur accorde le pouvoir, et l’obligation de transformer une société qui prive nos malheureux de tout usage réformiste du pouvoir qu’elle leur accorde.
C’est trop demander au capitalisme d’accorder des faveurs qui vont à l’encontre de ses intérêts, lorsque de telles concessions ne sont pas nécessaires à son maintien. à l’heure actuelle, la conservation du mode de production implique le renoncement à la plus petite réforme qui soit. Il faut par conséquent l’abattre. Mais c’est trop demander à un parti de renoncer à sa raison d’être qui est la conquête du pouvoir, pouvoir qui n’existe que dans les conditions capitalistes de la société. Nos sociaux-démocrates doivent donc transformer le capitalisme en le conservant – d’où le rêve d’un retour à l’État-providence, ou plus pragmatiquement renoncer à toute transformation, comme l’ont déjà fait M. Tsipras et ses suivants.
Syriza a pourtant rempli son rôle. Les partis de gauche n’ont qu’une utilité, celle de donner l’illusion d’une issue électorale au désastre, c’est-à-dire retarder autant que possible le retour d’une situation révolutionnaire.
M. Tsipras a été porté deux fois à la tête de l’État parce qu’il a récupéré et désarmé une contestation autrement plus profonde. Les grecs ont reporté sur lui des espoirs de liberté qui ont évidemment été déçus. Mais il n’y a pas eu de trahison, le parti n’est pas passé à l’ennemi. Il a seulement été contraint de révéler ce qu’était, depuis le début, son véritable camp. La farce est jouée, le rideau tombe. La débâcle de Syriza est si flagrante qu’elle pourrait raviver les flammes que le parti essayait d’éteindre.
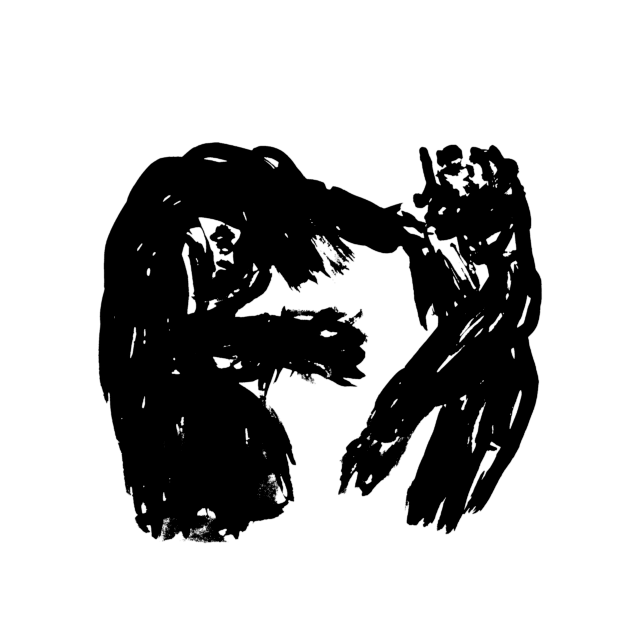
La lutte
Marchander les conditions de l’exploitation, avec pour seule ambition la vente des salariés au meilleur prix, a été le travail des syndicats et des partis « progressistes » du siècle dernier. C’est ce que certains d’entre eux promettent encore, sans avoir de quoi tenir leur promesse. La seule manière de faire advenir un changement est de couper court au chantage à la survie, qu’on ne peut plus négocier. Le recours révolutionnaire a toujours été le seul valable. C’est désormais le seul possible.
Le capitalisme tire son pouvoir d’un état de fait ; il se confond avec la production de l’existence. D’une certaine manière, il assure la reproduction de la vie humaine, mais il le fait de façon à supprimer tout usage humain et social de cette existence comme de cette production. Sa concentration et son maintien ne s’obtiennent que par l’accumulation toujours croissante et mécanique de la valeur abstraite, autrement dit par l’augmentation infinie de ce que cela rapporte en argent, toujours aux mêmes, et au-delà de tout autre considération. à tel point que le capitalisme en est venu, depuis plusieurs décennies déjà, à ce paradoxe : il produit l’existence d’une façon qui provoque la destruction de l’humanité et du monde.
Si le recours à l’action révolutionnaire est le seul valable, la seule révolution qui vaille est donc celle qui s’attaque aux bases matérielles de la domination, au mode de production. L’activité productive de la société doit être dirigée par la société elle-même, et pour elle. Les choses empirent ; il faut produire autrement non plus pour vivre autrement, mais pour vivre. Le soutien apporté cet été aux immigrés de la place Pedio tou Areos montre qu’une organisation spontanée et démocratique est capable, mieux que tous les gouvernements ou n’importe quel propriétaire, de comprendre les nécessités d’une situation et d’y répondre. Ce genre d’initiatives laisse entrevoir, si elles venaient à se généraliser, la qualité retrouvée d’une production soumise à l’usage humain, et les possibilités qu’offriraient une réelle auto-émancipation. Pendant quelques semaines, les gens de ce quartier d’Athènes ont pu, à moindre échelle, être témoin de la liberté d’une société qui n’avait d’autre médiation qu’elle-même.
C’est donc avec le salariat qu’il faut rompre en premier, lui qui, comme le rappelait quelqu’un, est incompatible avec la démocratie. Un salarié, par définition, ne choisit pas ce qu’il fait, ni comment il le fait, ni le montant de la compensation nécessaire à un emploi si vide. Il ne décide rien, obéit à tout, ne saurait se concerter avec ses égaux qui ne sont que des concurrents. Rouage esseulé de la machine, il est tout l’opposé d’un groupe vivant capable de se comprendre lui-même et d’agir en conséquence, de faire librement l’expérience des contradictions qui le traversent, d’éprouver sa capacité réelle à les surmonter. Ce sont de tels groupes qu’il s’agit de former, sur les lieux mêmes de la production, et qu’il s’agit d’étendre à l’ensemble de l’activité sociale.
Une rupture pareille avec l’organisation privée de la production ne peut se faire sans représailles de la part de quelques-uns qui ont tout à y perdre, et sans causer pour cela quelques frayeurs chez la vaste majorité qui a tout à y gagner. Cependant, il faut se rappeler une chose. Lorsqu’un tel mouvement a lieu, on n’échange pas un confort contre un inconfort.
D’abord, parce que malgré ses couleurs vives et ses enrobages divertissants, la marchandise empoisonne tout, et ce dans un sens très littéral. Chimie alimentaire et pesticides en tout genre, perturbateurs hormonaux imprégnés aux vêtements, pollution à particules, radiations nucléaires, amiante des bâtiments et plastiques cancérigènes sont devenus pour elle une nécessité vitale, et pour ses serviteurs autant de sources de mort et de maladie.
Ensuite parce que la pseudo-austérité des soit-disant riches déploie toute sa barbarie en causant les mêmes dégâts que pourrait occasionner une rupture sociale avec la logique marchande, mais pour maintenir cette logique, non s’en libérer. Les files d’attentes devant les distributeurs de billets disparaissent si l’on en finit avec l’argent. La pénurie monétaire infligée à la Grèce il y a quelques mois, après des années de soumission aux mémoranda, montre qu’avec la domination économique en place, les humiliations faites au peuple sont le prélude à des humiliations plus grandes encore. Des sacrifices similaires pourraient être subis pour rétablir la société sur une base qui les rendrait impossibles. « L’homme que les plaisirs feraient hésiter se verrait bientôt dépouillé des agréments qui causent son hésitation » disent les Corinthiens chez Thucydide.
Ce qu’il s’agit de prouver en actes, c’est la capacité partagée par tous les membres de la société de faire leur propre histoire, dans tous les domaines de la vie. Ce qui implique de refuser radicalement tous les débris de partis et de syndicats qui n’ont de cesse de ré-instaurer les formes étatiques du pouvoir et de la représentation, de s’ériger en spécialistes de l’organisation voire de la liberté, et qui cultivent en eux l’absurde prétention de diriger les autres, c’est-à-dire d’écrire l’histoire à leur place. Il n’y a que par ce refus qu’une prise en main collective des moyens d’existence, organisés au gré des besoins et des envies de la société elle-même, est envisageable.
Ainsi la Grèce pourra enfin se soustraire à la dictature économique, qui est partout chez elle. L’enjeu d’une telle libération ne se limite d’ailleurs pas à un peuple, ni même à l’ensemble de l’humanité, mais s’étend à tout ce qui vit. La plus grande solidarité humaine qui résulte de cette nouvelle manière de faire induit une solidarité renouée avec le monde matériel, particulièrement mis à mal. « Eh, quoi ? Tout est sensible. » dit Pythagore, dont l’adage ne cesse de se vérifier, une dégradation du vivant en entraînant une autre. Ce n’est pourtant pas une fatalité. La Grèce a inventé la démocratie une première fois, elle peut le faire à nouveau. Il n’y a que par là que la mer pourrait à terme retrouver ses couleurs, le soleil cesser d’être une source de maladies, et les îles la propriété de quelques-uns qui n’y séjournent pas. Périclès disait d’Athènes qu’elle était l’école de la Grèce. Avec une révolution, la Grèce pourrait devenir l’école du monde.
*
Octobre 2015

